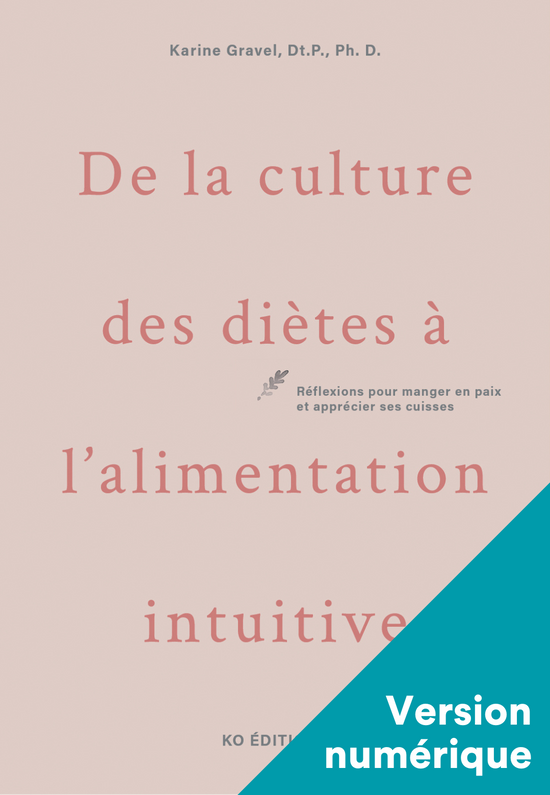Et si on parlait de condition féminine ?
La lutte à la grossophobie : un enjeu féministe intersectionnel
par Mélanie Therrien, historienne féministe et agente de communication à D’Main de Femmes
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours vécu dans un corps gros. Dès mes premières semaines de vie, on a dit de moi que j’étais bien dodue. Puis, peu à peu, ces petits bourrelets qui apparaissaient mignons et acceptables pour un bambin deviennent tout à coup source d’inquiétude en vieillissant. Pourquoi ce regard sur moi a-t-il changé? Qu’est-ce qui pousse les gens à émettre des commentaires et des opinions non sollicités sur les corps gros, même s’ils sont bien souvent faits sous le couvert de bonnes intentions ? La réponse se trouve fort probablement dans la culture des diètes, le culte de la minceur et leur cousine, la grossophobie.
La grossophobie : c’est la peur des gros? Pas tout à fait…
Prenons le temps de définir ce qu’est la grossophobie et de ses différentes déclinaisons. Dans un guide informatif sur cet enjeu créé pour l’organisme communautaire Arrimage Estrie, la journaliste et créatrice de contenu de sensibilisation sur la grossophobie Édith Bernier du blogue Grossophobie.ca nous informe que même si en théorie le dictionnaireLeRobert définit la grossophobie comme une « attitude de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids », on peut la définir concrètement comme « une vaste et complexe gamme de comportements, de réactions, d’émotions, de jugements, de prédispositions, etc. La grossophobie peut s’exprimer de nombreuses façons, du geste complètement délibéré à des réactions ou des choix plus subtils, parfois même inconscients ». Maintenant, voyons comment elle impacte la vie des femmes…
La grossophobie : un enjeu féministe intersectionnel
Cet enjeu touche particulièrement les femmes dont le corps est contrôlé depuis toujours. Dans son livre De la culture des diètes à l’alimentation intuitive : réflexions pour manger en paix et apprécier ses cuisses, la nutritionniste Karine Gravel affirme que les femmes sont assurément ciblées par la culture des diètes qui critique constamment l’apparence physique des femmes, alors qu’on le fait peu ou pas avec leurs semblables masculins. Les injonctions à la minceur féminine comme méthode de domination ou d’asservissement font partie intégrante de l’histoire de la grossophobie, qui est une composante de la lutte féministe, encore de nos jours. On impose un devoir de minceur aux femmes et on les force dans une position d’infériorité, voire de soumission, allant même jusqu’à les infantiliser et à les considérer comme indignes tant que leur « devoir de minceur » n’est pas rempli et maintenu.
Dans Antirégime : découvrez l’alimentation intuitive et faites la paix avec votre corps, Christy Harrison propose un rapprochement entre les pressions pour accentuer la culture des diètes et les moments forts des avancées des femmes dans l’histoire. « Comme l’avance la féministe Naomi Wolf, les moments de l’Histoire où les femmes ont fait le plus de gains politiques – droit de vote, liberté de reproduction, droit de travailler à l’extérieur de la maison – ont correspondu à ceux où la minceur était la plus valorisée et où la pression visant à respecter cet idéal de beauté était la plus forte. » Elle poursuit en disant que : « Si les femmes étaient occupées à maigrir, elles n’auraient pas le temps ou l’énergie de faire bouger les choses! Il est difficile de combattre le patriarcat quand on a l’estomac vide ou la tête pleine de préoccupations concernant la nourriture ou le corps ; or, c’est exactement ce que fait la culture du régime. »
Mais Mélanie, de quelles façons fait-on preuve de grossophobie?
La grossophobie se décline sous plusieurs formes. Il est possible que nous ayons des comportements grossophobes sans même le savoir. Pour éviter cela, il importe de s’informer sur les diverses formes que la grossophobie peut prendre. Dans son livre Grosse, et puis?, Édith Bernier en parle amplement. Peut-être avez-vous eu la chance de la voir lors de la conférence dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes de 2022. Je vous encourage vivement à emprunter la copie de son livre dans le centre de documentation et d’y explorer, entre autres, la portion historique de la culture des diètes que nous n’aborderons malheureusement pas ici par manque d’espace. Pour ce billet de blogue, prenons le temps de comprendre les quatre formes les plus courantes soit la grossophobie évidente, la grossophobie internalisée, la grossophobie structurelle et la grossophobie médicale. Voyons comment Édith Bernier les définit.
La grossophobie évidente associe les personnes grosses à des clichés et des stéréotypes. Par exemple, on dit de ces personnes qu’elles sont lâches, paresseuses, incompétentes, stupides. On pense que les personnes grosses manquent de contrôle d’elles-mêmes, qu’elles sont gourmandes, égoïstes, agressives et même sales. On présume la raison pourquoi une personne est grosse uniquement en se basant sur un fait isolé, comme la voir manger dans un restaurant de nourriture rapide, par exemple.
La grossophobie internalisée concerne notre discours interne qui associe notre propre valeur d’être humain au poids que l’on pèse sur la balance. Cela peut même entraîner une baisse d’estime de soi et la croyance qu’on est une moins bonne personne si l’on prend du poids. Dans le cas contraire, on peut même se valoriser par la perte de poids ou son maintien, encore plus si l’on convient aux standards de beauté de la société.
La grossophobie structurelle, quant à elle, ne prend pas en compte les besoins des personnes grosses lors du design de mobilier urbain ou autres structures ce qui peut amener les personnes grosses à s’isoler afin d’éviter la honte de ne pas pouvoir les utiliser confortablement car mésadaptées à leur corps. On peut penser aux sièges étroits dans les cinémas, dans les salles de spectacles, dans les salles de classe, et les banquettes de restaurants attachées aux tables, entre autres.
La grossophobie médicale peut se manifester de diverses façons. Sa forme la plus courante consiste à rejeter sur le poids du patient gros tout problème de santé. Les soins peuvent être de moins bonne qualité : investigations moindres, références à des spécialistes moins fréquentes, etc. Toutes ces formes de grossophobie génèrent de la stigmatisation et de la discrimination envers les personnes grosses, ce qui inévitablement entraîne des conséquences sur leur santé mentale et physique.
Pour ces raisons, la lutte contre la grossophobie et les stigmas concernant la diversité corporelle est essentielle. Ils sont partie prenante des enjeux féministes intersectionnels au même pied d’égalité que les autres enjeux. Chaque personne, peu importe son format corporel, a droit au respect, à la bienveillance et à un traitement équitable.
Pour poursuivre la réflexion :
Lectures
- Bernier, Edith. Grosse, et puis? : connaître et combattre la grossophobie. Montréal, Québec, Éditions du Trécarré, 2020.
- Gravel, Karine. De la culture des diètes à l’alimentation intuitive : réflexions pour manger en paix et apprécier ses cuisses. Montréal (Québec), KO éditions, 2021.
- Harrison, Christy et Paulette Vanier. Antirégime : découvrez l’alimentation intuitive et faites la paix avec votre corps. Montréal, Québec, Éditions de l’Homme, 2021.
Balados, blogues et capsules YouTube