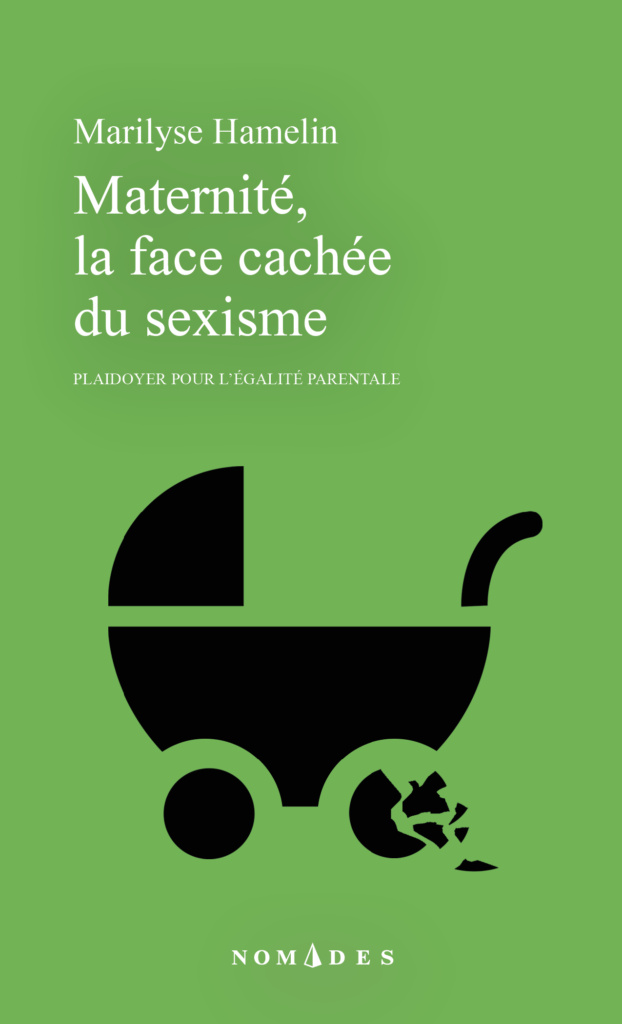Et si on parlait de condition féminine ?
Le travail invisible : générateur d’inégalités genrées dans les couples hétérosexuels
par Mélanie Therrien, historienne féministe et agente de communication à D’Main de Femmes
L’arrivée des enfants s’avère souvent la porte d’entrée des inégalités dans les couples hétérosexuels, et ce, même en 2024. J’en ai moi-même fait l’expérience dans le couple que je formais avec mon ancien partenaire. Différentes charges s’installent dans le quotidien et engendrent leur lot de décisions à prendre, ce qui demande du temps, de l’argent et de l’énergie, particulièrement pour les femmes. Dans ce billet de blogue, nous explorerons ces différentes charges et nous verrons comment elles peuvent impacter particulièrement la « classe des femmes » en freinant leurs opportunités d’épanouissement professionnel et personnel. Est-ce que les femmes peuvent tout faire, tout avoir et tout accomplir? C’est ce que nous verrons dans les prochaines lignes.
La lecture du livre Toutes les femmes sont d’abord ménagères de l’historienne Camille Robert nous informe que pendant longtemps, la croyance populaire voulait que ce soit « naturel » pour une femme de s’occuper de ses enfants, de son foyer et de son époux. Elle demeurait dans la sphère privée pendant que l’homme vaquait à ses occupations dans la sphère publique en jouant un rôle de pourvoyeur. L’arrivée des femmes sur le marché du travail au début du XXe siècle au Québec, dans les usines notamment, a graduellement permis de remettre en question ces croyances. C’est dans les années 1970 que la question du travail domestique a grandement été théorisée par des féministes dites de la « deuxième vague » où les questions privées étaient abordées publiquement et devenaient des enjeux politiques, d’où le slogan « Le privé est politique ». On y a, entre autres, parlé des violences sexuelles et conjugales, de la question de l’avortement, de la répartition des tâches au sein du couple, etc.
La sociologue et chercheuse, Christine Delphy a contribué au développement du courant féministe matérialiste dans les années 1970. Elle est d’avis que les hommes, en tant que classe, profitent largement de tous les avantages générés par le système capitaliste et patriarcal. Par exemple, un mari obtient de sa femme « ses heures travaillées et ses services personnels ». Ainsi, il économise de l’argent sur tout ce qui est produit à la maison (nourriture, entretien ménager, soin des enfants, jardinage, etc.) et dégage davantage de temps pour produire et accumuler des capitaux. En bonus, il reçoit du soutien personnel, des encouragements et de la valorisation, une partenaire sexuelle et même des enfants, s’il le désire.
Les statistiques montrent qu’il existe encore une grande disparité de genre quant au nombre d’heures travaillées gratuitement au profit de la famille. Dans cette veine, le Comité inter-associations pour la valorisation du travail invisible a publié le site web Le Travail invisible, ça compte. Ce comité inclut dans sa notion de travail invisible tout travail domestique, toute activité de proche aidance, tout bénévolat incluant le travail gratuit pour l’entreprise du mari, et plus encore. Toujours dans la portion définition du travail invisible sur leur site, le Comité indique que « [e]ncore aujourd’hui, ce travail est majoritairement effectué par les femmes, ce qui les pénalise dans leur épanouissement personnel, professionnel, social et économique. Ceci augmente pour ces femmes le risque de se retrouver en situation de précarité et de vivre en situation de pauvreté tout au long de leur vie. »
Ces charges assumées majoritairement par la classe des femmes sont ce qu’on appelle le travail du care qui consiste en un ensemble de soins donnés autant à des personnes dépendantes (enfants, aînés, malades, etc.) qu’à des personnes indépendantes. Selon la chercheure Cécile Gagnon dans son article « Charge mentale et éthique du care : la division du travail dans la sphère domestique comme enjeu de justice sociale » paru en 2019 dans la revue Ithaque, le travail du care permet « d’anticiper et de constater les besoins d’autrui afin d’y faire face et de les prendre en charge. » Ce travail contribue à maintenir la vie quotidienne et le développement des institutions économiques, politiques, sociales et culturelles.
Il n’y a pas que la charge mentale!
Prenons maintenant le temps de décortiquer les différentes charges inhérentes au travail du care dans une famille. Dans son avis « Pour un partage équitable du congé parental » publié en 2015, le Conseil du Statut de la Femme indique qu’aujourd’hui, malgré les avancées féministes, le travail du care est encore perçu comme allant « naturellement » aux femmes. Elles se retrouvent alors responsables de tâches récurrentes comme la cuisine, le nettoyage et le soin aux enfants. Les tâches plus ponctuelles comme sortir les poubelles, tondre la pelouse et effectuer des travaux d’entretien reviennent souvent à la classe des hommes. Les tâches routinières empiètent sur le temps et l’énergie disponibles limitant ainsi les perspectives professionnelles. Bien qu’il existe plusieurs nuances dans les expériences vécues par les couples, les charges et rôles parentaux qui seront proposés ici semblent toucher la plupart d’entre eux à différents degrés.
Bon, ok, je t’entends me dire :
« oui, mais moi, mon mari/conjoint/partenaire, n’est pas si pire… Il participe aux tâches! » Je sais, je sais, et je suis vraiment contente pour toi. Rappelle-toi qu’on ne parle pas d’expérience individuelle ici, mais bien d’observations faites par la recherche et les résultats statistiques. En général, la classe des hommes participe moins aux différentes charges domestiques que la classe des femmes.
Voyons maintenant un peu en quoi consiste ces différentes charges. Tu pourras t’amuser à les découvrir en parcourant les bandes dessinées très ludiques d’Emma portant sur la charge mentale et la charge émotionnelle, entre autres.
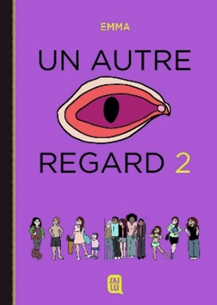
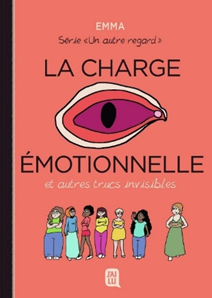
Charge mentale La charge mentale comprend à la fois la planification des besoins familiaux à venir, la gestion du quotidien, les tâches domestiques à accomplir, les rendez-vous à prendre, de leur acheter des vêtements sans même qu’ils n’aient à le demander. Bref, un travail qui est renouvelable d’une journée à l’autre.
Charge émotionnelle Dans la société patriarcale, on présume d’emblée que la classe des femmes fournira gratuitement et automatiquement un travail émotionnel invisible qui ne donnera droit à aucune compensation financière. Dans le couple hétérosexuel, cela se traduit par le fait de prendre soin de son conjoint et de ses enfants afin de s’assurer de leur bien-être, de leurs besoins émotionnels, de les écouter lorsqu’ils en ressentent le besoin. En gros, il s’agit de s’assurer de leur rendre la vie confortable afin qu’ils se sentent bien.
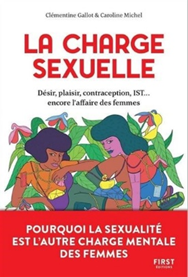
Charge sexuelle Clémentine Gallot et Caroline Michel définissent la charge sexuelle dans leur livre La charge sexuelle : désir, plaisir, contraception, IST… encore l’affaire des femmes comme le fait de s’inquiéter du désir d’autrui, de son plaisir, de chercher des informations pour créer une vie sexuelle épanouie, de « se mettre belle » pour susciter le désir du partenaire, de s’assurer des moyens de contraception lorsqu’ils sont requis, d’entretenir une santé sexuelle saine en visitant son professionnel de la santé régulièrement, entre autres.
Charge d’enrôlement En plus des différentes charges mentionnées précédemment, la charge d’enrôlement incombe également à la classe des femmes. Il s’agit ici d’éduquer le conjoint et de l’enrôler dans les différentes responsabilités et charges domestiques. Il ne s’agit pas ici de simplement exécuter une liste préalablement réfléchie et écrite par elles, mais plutôt de les amener à s’investir dans l’ensemble des responsabilités domestiques, incluant la réflexion et l’anticipation.
Conclusion
Dans son livre Maternité, la face cachée du sexisme, l’autrice Marilyse Hamelin démontre bien que les inégalités genrées subsistent au sein des couples hétérosexuels en grande partie causées par le système patriarcal. Lorsque la classe des femmes réfléchit à la maternité et la carrière et se pose la question qui enflamme les débats féministes : « est-ce que les femmes peuvent tout avoir? », […], force est de répondre que non. La nouvelle formule magique à la mode est de dire que oui, elles peuvent tout avoir, mais pas en même temps ». Elles vont devoir renoncer à plusieurs rêves et ambitions tant que l’égalité ne sera pas atteinte. Et pour cela, des changements structurels s’avèrent nécessaires, tant aux niveaux symbolique, économique que politique. Malgré tout, je garde espoir pour les générations futures. Il est encore possible de transformer la société et tendre vers l’égalité. Collectivement, nous y arriverons.
Pour poursuivre la réflexion
- Emma, Un autre regard, Paris, Massot éditions, 2017, 112 p.
- Emma, La charge émotionnelle: et autres trucs invisibles, Paris, Massot éditions, 2018, 112 p.
- Gagnon, Cécile, « Charge mentale et éthique critique du care : la division du travail dans la sphère domestique comme enjeu de justice sociale », dans Ithaque, Montréal, 2019, p. 23‑44.
- Gallot, Clémentine et Caroline Michel, La Charge sexuelle: désir, plaisir, contraception, IST… encore l’affaire des femmes, Paris, 2020, FIRST, 198 p.
- Hamelin, Marilyse, Maternité, la face cachée du sexisme: plaidoyer pour l’égalité parentale, Montréal, Leméac, 2017, 181 p.
- Robert, Camille, Toutes les femmes sont d’abord ménagères: histoire d’un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager: Québec 1968-1985, Montréal, Éditions Somme toute, 2017, 178 p.
Sites web, balados, comptes à suivre